Pour une diplomatie radicalement nuancée vis-à-vis de l’Iran
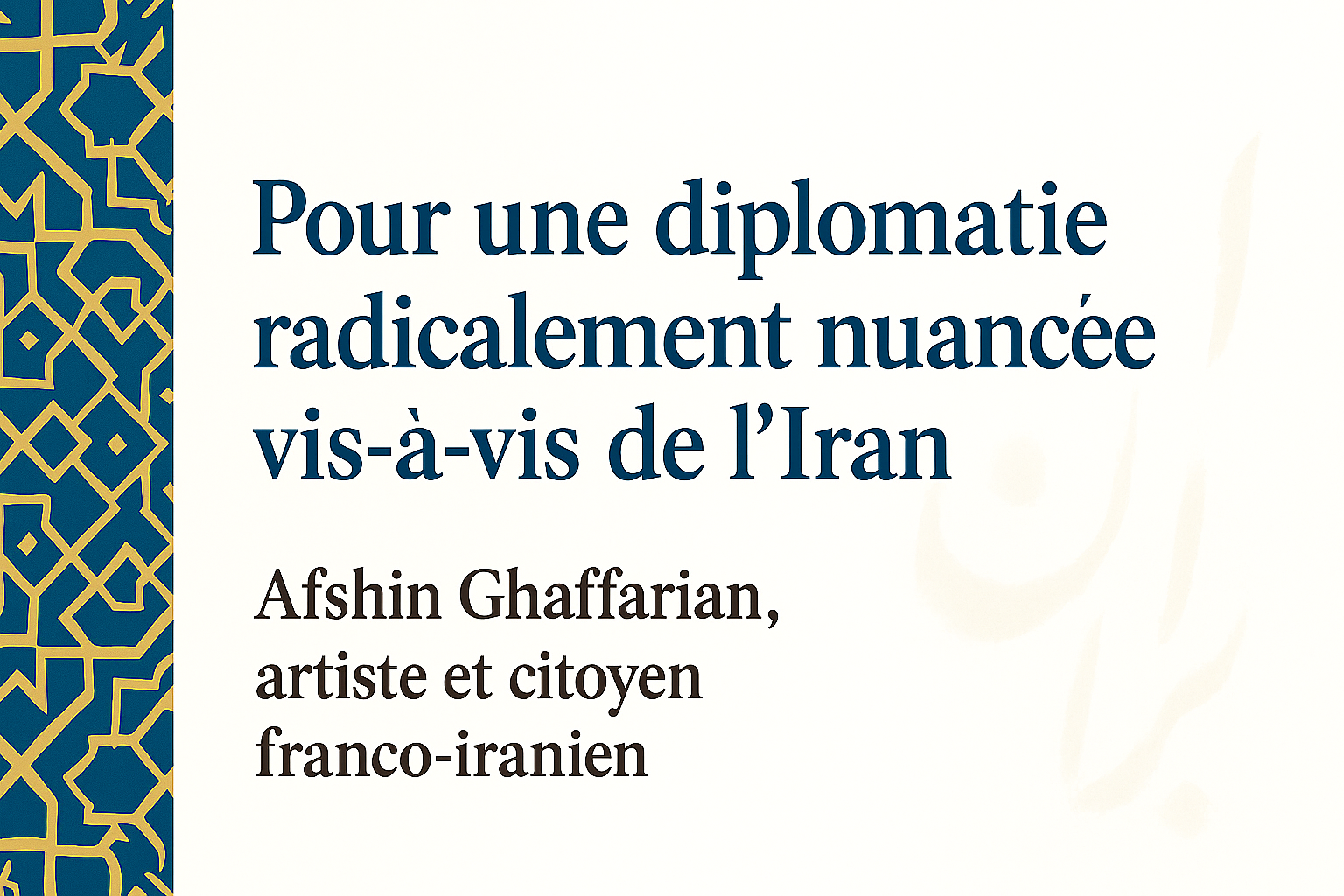
Depuis des mois, l’Iran subit un récit occidental imprégné de mépris et de clichés. Ce texte appelle à rompre avec l’alignement diplomatique automatique et plaide pour une posture française à la fois critique, respectueuse et lucide : une diplomatie radicalement nuancée.
Par Afshin Ghaffarian, artiste et citoyen franco-iranien
L’Iran, mon pays d’origine, subit aujourd’hui une guerre imposée par l’État d’Israël. Depuis ici, je ne peux qu’assister, impuissant, aux bombardements, aux destructions, à la mort de centaines de civils — femmes, enfants, anonymes — dont les noms ne sont jamais prononcés dans les médias. Je porte ainsi une double souffrance: voir ma patrie attaquée par une puissance étrangère et entendre la violence du discours qui, ici en France, entoure mon pays d’origine.
Ce texte est né d’une conviction intime et d’un besoin de poser des mots sur une réalité trop souvent déformée.
Dans les médias mainstream, l’Iran est souvent présenté comme un bloc homogène, irrationnel, fanatique. Or, mon histoire personnelle – à la fois critique du pouvoir iranien et opposée à toute entreprise de diabolisation – témoigne d’une réalité plus nuancée. On peut fuir la censure sans souhaiter la guerre. On peut dénoncer la répression sans adhérer aux logiques impérialistes. On peut vivre en exil sans se reconnaître dans ceux qui, au nom de la liberté et de la démocratie, appellent à l’effondrement et au chaos.
Aujourd’hui, face à la montée des tensions, au retour des logiques de bloc et à l’aveuglement diplomatique, je crois qu’il est plus urgent que jamais de changer notre regard sur l’Iran – non pour l’absoudre, mais pour enfin le comprendre. Mais face à la puissance de la propagande médiatique en France, qui déforme, caricature et diabolise, je me heurte à un mur d’indifférence ou de suspicion.
Pourtant, je connais l’histoire profonde de ce pays, sa culture, ses luttes, ses contradictions. Et je sais une chose : l’Iran ne se soumettra pas. Ni à la guerre imposée par Netanyahou, ni à la paix imposée comme une capitulation par Trump. Il résistera — et de cette épreuve, il sortira plus soudé, plus résilient, et probablement plus respecté par les peuples du Sud global.
Il est temps de rompre avec l’illusion persistante d’un renversement imminent du régime iranien, souvent entretenue par certains opposants médiatisés.
À chaque période de tension en Iran, les mêmes récits ressurgissent : l’État serait « au bord de l’effondrement », « rejeté en bloc par sa population », et sur le point d’être balayé par une insurrection populaire. Ces discours, relayés complaisamment par une partie des médias occidentaux, se heurtent pourtant à la réalité politique et sociale bien plus complexe.
S’obstiner dans ce mauvais calcul, c’est se condamner à des erreurs d’analyse stratégiques et nourrir des politiques étrangères fondées sur le fantasme plutôt que sur les faits.
l’Iran ne se soumettra pas. Ni à la guerre imposée par Netanyahou, ni à la paix imposée comme une capitulation par Trump. Il résistera — et de cette épreuve, il sortira plus soudé, plus résilient, et probablement plus respecté par les peuples du Sud global.
Je crois que ce moment historique est aussi une opportunité. Une chance de repenser, ici en France, notre façon de regarder l’Iran. Une chance de sortir des réflexes conditionnés, des amalgames faciles, des silences coupables. Si nous voulons construire une politique étrangère alternative, réaliste et émancipatrice, alors, il est temps d’oser un autre regard sur l’Iran. Ce texte est ma manière d’y contribuer, humblement mais avec détermination.
À l’heure où les tensions internationales se multiplient, il me semble indispensable que la France retrouve une parole singulière et une diplomatie autonome, loin de l’alignement systématique sur les positions des États-Unis ou de l’OTAN. Cette exigence prend tout son sens s’agissant de la relation entre la France et la République islamique d’Iran, aujourd’hui fondée sur un mélange de posture idéologique, de silence politique et de suivisme diplomatique. À ce titre, il me semble essentiel de reconsidérer la posture française vis-à-vis de l’Iran à l’aune de principes plus justes, plus cohérents et véritablement indépendants.
Sortir d’une vision manichéenne : l’Iran n’est pas notre ennemi
Si la France défend une politique étrangère fondée sur la souveraineté des peuples, la non-ingérence et une lecture nuancée des rapports de force mondiaux, alors Il est temps d’appliquer cette grille de lecture à l’Iran, trop souvent perçu dans les cercles médiatiques et diplomatiques français à travers un prisme idéologique binaire et déformant.
L’Iran est un pays complexe, traversé par de réelles tensions sociales, des aspirations démocratiques profondes, mais aussi par une histoire politique singulière. La République islamique d’Iran n’est pas le résultat d’une intervention étrangère ni d’un coup d’État militaire, mais bien d’une grande révolution populaire survenue en 1979. Alors que la plupart des analystes spécialisés affirmaient qu’aucune révolution n’était plus possible à la fin du XXe siècle, la société iranienne s’est pourtant soulevée de manière profonde et rapide, mettant fin à une monarchie autoritaire corrompue, soutenue activement par les puissances occidentales.
Cette surprise révolutionnaire, portée par un large front social — des religieux aux ouvriers, étudiants et classes rurales — a inscrit l’anticolonialisme et la souveraineté nationale au cœur de son projet.
Un de ses slogans fondateurs, scandé dans les rues par des millions de manifestants, résumait avec puissance l’esprit du mouvement :
« Indépendance, liberté, République islamique » (Esteqlāl, āzādī, jomhūrī-e eslāmī).
Ce mot d’ordre synthétisait à la fois la volonté d’autonomie vis-à-vis des ingérences étrangères, l’aspiration à une justice sociale élargie, et la construction d’un système politique nouveau, ancré dans la culture nationale.
Réduire aujourd’hui l’Iran à un régime “irrationnel”, “théocratique” ou “barbare”, sans tenir compte de ses dynamiques internes, de ses évolutions sociales, de ses débats politiques ou de son rôle régional, relève non pas d’une analyse, mais d’un préjugé idéologique.
Cette caricature persistante alimente une logique de confrontation permanente et empêche toute politique de désescalade. Or, l’Iran ne constitue en aucun cas une menace directe ou structurelle pour la France. Au contraire, il est régulièrement la cible de sanctions unilatérales, de cyberattaques, d’un isolement diplomatique, et d’opérations secrètes menées avec l’appui ou la complicité d’acteurs occidentaux.
Pourtant, cette lecture idéologisée continue d’être relayée au sommet du débat médiatique et politique. Bernard-Henri Lévy déclarait récemment sur CNews que la guerre entre Israël et l’Iran était “naturellement notre guerre”, ajoutant que l’Iran représentait “une menace essentielle” pour la France. Ce type de propos, qui appelle à un alignement automatique avec les positions de Tel-Aviv et de Washington, contribue à entretenir un climat de peur, de confusion et de diabolisation, incompatible avec une diplomatie fondée sur l’indépendance et la raison.
Dans la même veine, Friedrich Merz, le chancelier conservayeur allemand , a récemment affirmé qu’Israël faisait “le sale boulot pour nous tous” en Iran. Une déclaration glaçante, révélatrice d’une posture de délégation morale et stratégique à une puissance étrangère, et qui en dit long sur la manière dont certains responsables politiques européens conçoivent leur rapport à la guerre et à la souveraineté des peuples du l’Asie de l’Ouest (Moyen-Orient).
Réduire aujourd’hui l’Iran à un régime “irrationnel”, “théocratique” ou “barbare”, sans tenir compte de ses dynamiques internes, de ses évolutions sociales, de ses débats politiques ou de son rôle régional, relève non pas d’une analyse, mais d’un préjugé idéologique.
Dans ce contexte, l’image de la France en Iran s’est gravement détériorée au cours des dernières années. Les prises de position françaises, perçues comme systématiquement alignées sur les États-Unis ou Israël — notamment lors des votes à l’ONU ou dans la communication politique — ont été interprétées en Iran comme une rupture de la tradition diplomatique française d’indépendance et d’équilibre. Le soutien à des figures d’opposition perçues en Iran comme inféodées à des puissances étrangères a également contribué à accentuer la méfiance.
Pourtant, historiquement, la France a joui d’un immense capital de sympathie en Iran : une culture respectée, des liens scientifiques et universitaires solides, une présence économique appréciée, un respect mutuel enraciné.
Ce lien s’est notamment illustré à travers des figures comme Henry Corbin, philosophe et islamologue français, qui a su adopter une approche intellectuelle décentrée pour comprendre la richesse de la pensée chiite iranienne. Son dialogue avec des savants religieux iraniens tels qu’Allameh Tabatabaï a marqué une étape importante dans la reconnaissance de la philosophie islamique comme tradition vivante et complexe, digne d’être étudiée au même titre que les grandes pensées occidentales.
Il ne faut pas oublier ce qui reste l’un des faits les plus marquants dans l’histoire des relations franco-iraniennes : la France a accueilli l’Ayatollah Khomeini à Neauphle-le-Château pendant son exil, juste avant son retour en Iran, en février 1979, pour conduire la révolution à la victoire. Ce geste a profondément marqué la mémoire collective iranienne et inscrit la France comme un pays alors respecté pour sa position d’accueil, d’écoute et de distance critique à l’égard des puissances impériales.
L’époque du Général de Gaulle, son refus de l’alignement sur les blocs, ainsi que le rôle de médiateur joué par la France dans le dossier nucléaire iranien, ont également contribué à forger cette confiance aujourd’hui très affaiblie.
Il est temps de rétablir cette image, non par naïveté, mais par réalisme stratégique. Refuser la diabolisation de l’Iran, reconnaître ses spécificités sans approuver toutes ses politiques internes, et ouvrir un dialogue diplomatique basé sur le respect mutuel, permettrait à la France de retrouver une voix utile dans la région et de contribuer à une paix durable.
La République islamique d’Iran et la théologie de la libération : vers une lecture politique, non idéologique
Pour sortir des schémas simplistes qui dominent les débats sur l’Iran, il est urgent d’adopter une lecture qui dépasse les prismes occidentaux, notamment ceux d’une laïcité rigide et de l’universalisme abstrait.
La révolution islamique de 1979 en Iran a été avant tout un mouvement populaire, massivement ancré dans les classes populaires et les zones rurales, porté par une critique radicale du capitalisme monarchique, de l’impérialisme occidental et de la dépendance aux puissances étrangères. Ce soulèvement, bien qu’ayant pris une forme religieuse, doit être lu comme l’expression d’un anti-impérialisme et anti-capitalisme populaire, inspiré par une vision spirituelle de justice sociale et de dignité des opprimés. On peut ainsi parler d’une forme de théologie de combat — une version chiite de ce que l’Amérique latine a connu sous le nom de théologie de la libération.
Comme cette dernière, l’islam révolutionnaire iranien a mobilisé les référents religieux non pas pour conserver l’ordre, mais pour le subvertir depuis les marges, au service des pauvres (mostazafin) et contre les puissances dominantes (estekbar). Il ne s’agit pas ici de défendre un régime religieux, mais de reconnaître que des luttes anticoloniales et anti-impérialistes peuvent se structurer autour de référents culturels et spirituels qui ne correspondent pas nécessairement aux normes occidentales.
C’est pourquoi La France, si elle veut demeurer fidèle à son engagement anti-impérialiste, doit étendre son référentiel au-delà de la seule matrice laïque européenne. Elle doit s’ancrer dans une tradition de luttes qui unit les peuples du Sud global, quelles que soient leurs formes d’organisation ou leurs cultures. Cela implique de repenser les alliances internationales sur des bases politiques et non idéologiques, en reconnaissant que des convergences concrètes sont possibles autour de la lutte contre l’impérialisme, la justice sociale, la souveraineté des peuples — y compris avec des États comme l’Iran.
La cause palestinienne: pour une diplomatie anti-coloniale
L’Iran est l’un des rares États à soutenir activement, concrètement et sans condition la résistance palestinienne. Ce soutien est souvent présenté dans les médias occidentaux comme une preuve d’hostilité ou de fanatisme, et l’Iran est régulièrement accusé d’antisémitisme. Or, cette accusation est infondée : la communauté juive d’Iran – la plus importante de l’ Asie de l’Ouest ( Moyen-Orient ) après celle d’Israël – y vit de façon reconnue et protégée par la Constitution. Cette caricature de l’Iran alimente son isolement diplomatique, sa diabolisation et, parfois, sa criminalisation sur la scène internationale. En effet, l’Iran est aujourd’hui l’un des rares contrepoids régionaux face à l’expansionnisme israélien. L’Iran dénonce l’occupation israélienne des territoires palestiniens et soutient officiellement la tenue d’un référendum incluant tous les habitants d’origine palestinienne — y compris les réfugiés — pour déterminer l’avenir politique de ce territoire. L’Iran se positionne en faveur d’un seul État, possiblement binational sur la totalité de la Palestine historique, dans lequel Juifs, Chrétiens et Musulmans vivraient ensemble dans l’égalité des droits sous un gouvernement démocratiquement élu.
Même si le courage pour défendre les droits des Palestiniens manque cruellement à beaucoup de partis politiques français, dans une atmosphère médiatique hostile mais pour construire une diplomatie active au service de la paix, nous devons passer par l’acceptation d’alliés inattendus. Refuser de parler à l’Iran au prétexte de son soutien au mouvement de résistance HAMAS, c’est faire le jeu d’Israël et des va-t-en-guerre.
Or, cette accusation [antisémitisme] est infondée : la communauté juive d’Iran – la plus importante de l’ Asie de l’Ouest ( Moyen-Orient ) après celle d’Israël – y vit de façon reconnue et protégée par la Constitution.
Cela suppose une lecture plus nuancée, désoccidentalisée et informée de la réalité sociale, politique et régionale de l’Iran. Il est impossible d’ignorer que dans de nombreux quartiers populaires en France, une partie importante de la jeunesse, issue de l’immigration et solidaire des luttes palestiniennes, exprime son admiration pour la posture de l’Iran : son soutien actif à la résistance palestinienne, son refus de l’hégémonie américaine et sa capacité à défier tout seul Israël.
Il ne s’agit pas d’idéaliser le pouvoir iranien avec ses limites démocratiques, mais de reconnaître qu’il joue un rôle central et concret dans le soutien à la cause palestinienne, là où de nombreux États arabes ont abandonnés toute prétention de résistance. Cette posture est perçue, y compris en France, comme une forme de courage diplomatique.
Contre la guerre et les sanctions : pour une diplomatie humaine
Les sanctions économiques imposées à l’Iran depuis plus de quarante ans ont des conséquences dramatiques sur les populations civiles. Les sanctions tuent. Elles limitent l’accès aux médicaments et aux soins essentiels, détruisent les perspectives de développement et touchent en priorité les étudiants, les femmes, les enfants et les personnes atteintes de maladies génétiques comme Épidermolyse bulleuse. Leur impact relève davantage d’objectifs géopolitiques que de préoccupations liées aux droits humains.
Dans l’histoire contemporaine, aucune sanction n’a conduit à un changement durable de la ligne politique du gouvernement ciblé. Elles frappent les populations civiles, affaiblissent les sociétés et préparent souvent le terrain à des interventions militaires. En Irak, les sanctions imposées dans les années 1990 ont contribué à la mort de centaines de milliers de civils, dont une majorité d’enfants, selon plusieurs sources, notamment l’UNICEF. À Cuba, l’embargo imposé par les États-Unis depuis plus de 60 ans continue d’asphyxier le pays et martyrise son peuple.
Les sanctions américaines, punitives, unilatérales et souvent illégitimes et injustes en raison de leur extraterritorialité, doivent être dénoncées avec la même vigueur que celles imposées à Cuba ou au Venezuela. Leur levée est une condition indispensable à toute évolution démocratique intérieure en Iran. Elles sont en contradiction avec l’objectif que nous pouvons partager toutes et tous : la paix par le dialogue et non par l’asphyxie.
Pour que cette vision des choses soit pleinement comprise et mise en œuvre, il est nécessaire de déconstruire les récits dominants qui biaisent notre perception de l’Iran.
Contre les porte-voix de l’illusion : déconstruire le discours hégémonique de la diaspora iranienne
Toute notre compréhension actuelle de la République islamique d’Iran en France repose sur un récit largement biaisé, véhiculé par certains segments médiatisés de la diaspora iranienne. Il s’agit d’un espace militant, souvent structuré autour de trois grandes forces exilées :
-Les militants royalistes, qui défendent le retour à la monarchie sous Reza Pahlavi, fils du dernier Shah déchu en 1979. Ces réseaux, très présents dans les médias internationaux, idéalisent une époque autoritaire marquée par une forte dépendance à l’Occident.
-Les Moudjahidine du peuple (MEK), ancien mouvement marxiste-islamiste devenu un groupe d’opposition sectaire, sont aujourd’hui intégrés à des réseaux néoconservateurs internationaux (notamment aux États-Unis), à l’extrême droite européenne (comme le parti VOX en Espagne), ainsi qu’à certains cercles pro-israéliens. En France, ils bénéficient encore d’un soutien logistique et politique, notamment via (CNRI), basé à Auvers-sur-Oise.
-Certains groupes séparatistes instrumentalisés, kurdes, baloutches, arabes, Azéris, notamment le Komala et le Parti démocratique du Kurdistan iranien (PDKI), implantés dans le Kurdistan irakien, et bénéficiant d’appuis logistiques étrangers, notamment israéliens.
Leur mise en avant par certains médias ou institutions européennes participe d’une stratégie géopolitique hostile à la stabilité régionale — une stratégie à laquelle la France doit refuser de souscrire.
Ces trois pôles, bien que minoritaires dans la société iranienne, occupent une place disproportionnée dans les médias occidentaux et les sphères politiques, où ils se présentent comme “la voix du peuple iranien”. Ce déséquilibre entraîne une vision tronquée, caricaturale et dangereusement simpliste de l’Iran. Trois idées reçues en découlent (Ces trois idées reçues sont devenues des éléments de langage que l’on retrouve dans l’ensemble des rédactions médiatiques dominantes. ) :
1. L’irrationalité du régime
Le discours dominant présente l’Iran comme un pays appartenant à “l’axe du mal” avec un “ régime purement théocratique “, dirigé par des ” fous de Dieu “, sans aucune rationalité stratégique.
Cette lecture orientaliste nie le fait que la République islamique prend ses décisions selon des calculs géopolitiques pragmatiques, comme en témoigne son rôle dans les affaires des otages américains au Liban dans les années 1980, sa coopération ponctuelle avec les Etats Unis contre les Talibans en Afghanistan en 2001, sa politique régionale structurée (Irak, Syrie, Liban, Yémen), ses négociations sur le nucléaire ou ses efforts de rapprochement avec la Chine, la Russie, l’Amérique latine ou encore les BRICS.
Tout cela montre que l’Iran agit avec un certain pragmatisme géopolitique, et non de manière irrationnelle, comme le suggère parfois le discours dominant occidental.
2. L’illégitimité du régime
Une autre idée reçue présente l’État iranien comme totalement rejeté par sa population et donc “au bord de l’effondrement”. Certes, l’Iran est traversé par de fortes tensions sociales et aspirations démocratiques, mais cela n’implique pas l’absence totale de légitimité.
L’État iranien bénéficie encore d’ un soutien populaire important. Les funérailles du général Soleimani en 2020 en sont un exemple frappant : des millions de personnes sont descendues dans les rues en Iran et en Irak, un événement sans précédent pour une figure militaire dans l’histoire récente. Ce soutien se manifeste également à travers la participation de la population aux élections, malgré les restrictions et les limites du système électoral.
Même lors des manifestations, les slogans — tels que « Femme, vie, liberté » — ne visent pas nécessairement la chute de l’État, mais souvent l’amélioration des droits, des libertés et des conditions économiques. Cela traduit une volonté de réforme, plus qu’un rejet absolu du système.
« le système institutionnel iranien présente l’originalité de faire cohabiter deux légitimités », politique et religieuse, dans un équilibre souvent conflictuel mais évolutif.
Le système institutionnel iranien est atypique et souvent mal compris. Contrairement à des États voisins issus des accords Sykes-Picot, l’Iran s’est construit sur une base civilisationnelle ancienne. Ses composantes ethniques — Kurdes inclus — s’identifient majoritairement à cette identité, expliquant en partie la résilience du pays face aux pressions externes. Le peuple iranien participe activement à la vie politique en élisant ses représentants : le président de la République, les députés du Parlement (Majles), les conseillers municipaux, ainsi que les membres de l’Assemblée des experts sont tous élus au suffrage universel direct. Comme le rappelait déjà un rapport du Sénat français de 2003, ces élections sont réelles et largement suivies par la population, même si le processus de sélection des candidats est encadré par le Conseil des gardiens de la Constitution.
Cependant, les institutions issues du suffrage ne détiennent pas à elles seules l’ensemble du pouvoir politique. Le système iranien repose sur une architecture duale, où coexistent deux sources de légitimité :
Une légitimité démocratique, fondée sur le vote populaire et incarnée par les institutions élues ;
Une légitimité religieuse, incarnée par le Guide de la Révolution, autorité politico-religieuse, garant des principes de la Révolution de 1979.
Il est important de rappeler que même le Guide suprême est désigné par un suffrage indirect, à travers l’Assemblée des experts — elle-même élue au suffrage universel. Certes, le processus électoral et la composition de cette assemblée ne sont pas exempts de critiques, notamment en ce qui concerne la transparence, l’impartialité ou les critères de sélection des candidats, mais il
n’en reste pas moins que le principe d’une légitimation populaire, bien que partiellement encadrée, demeure inscrit dans l’architecture institutionnelle iranienne.
Ce fonctionnement à double légitimité – politique et spirituelle – n’est pas simplement un masque démocratique. Il constitue une originalité du modèle iranien, qui n’entre dans aucune catégorie préconçue des systèmes occidentaux. Le rapport du Sénat insistait d’ailleurs sur cette particularité : « le système institutionnel iranien présente l’originalité de faire cohabiter deux légitimités », politique et religieuse, dans un équilibre souvent conflictuel mais évolutif.
Or, cette complexité est régulièrement ignorée ou caricaturée dans le débat public français. Ces discours, complaisamment relayés par une partie des médias occidentaux, se heurtent pourtant à une réalité politique et sociale bien plus complexe. Réduire l’Iran à une dictature théocratique pur et dur empêche toute analyse sérieuse. Comprendre ce système dans ses contradictions, ses réformes internes et ses dynamiques sociales, c’est refuser le simplisme, et ouvrir la voie à une diplomatie fondée sur la connaissance, le respect mutuel et l’intelligence stratégique.
3. L’isolement international
Enfin, l’Iran est décrit comme un pays, extrêmement “isolé du monde”, “au bord de la faillite”.
Or, Téhéran multiplie les partenariats avec des puissances émergentes : Chine (accord stratégique de 25 ans), Russie (coopération militaire et énergétique), Venezuela, Irak, Inde, Qatar…
En 2023, l’Iran a officiellement intégré l’Organisation de coopération de Shanghai et les BRICS+. Cette insertion active dans un ordre multipolaire est facilitée par sa cohésion nationale, rare dans la région : un État-nation ancré dans une histoire millénaire, où Kurdes, Azéris ou Baloutches se perçoivent comme Iraniens, contrairement aux fractures ethniques artificielles héritées du colonialisme chez ses voisins.
Une diaspora minoritaire, mais surmédiatisée
Le problème n’est pas que la diaspora exprime son désaccord — c’est son droit. Le problème est que seules les voix les plus radicales, alignées sur les intérêts atlantistes ou les nostalgiques d’un ordre monarchique, sont écoutées.
Des figures comme Masih Alinejad, très présente dans les médias occidentaux, militent ouvertement pour une intervention étrangère en Iran, avec le soutien de think tanks conservateurs américains.
Le MEK, pourtant classé comme organisation terroriste jusqu’en 2012 par l’Union européenne et les États-Unis, est reçu au Parlement français, à Bruxelles, ou encore sur les plateaux de chaînes comme LCI ou CNews.
Résultat : l’opinion publique en France est souvent enfermée dans cette bulle idéologique, pensant que ces figures parlent au nom du peuple iranien. Ce n’est pas le cas. (cf. Tribune dans le Monde de Fariba Adelkhah, 24/06/2025)
Pour rééquilibrer la lecture politique et construire une politique étrangère juste et cohérente vis-à-vis de l’Iran, il faut d’abord sortir de cette médiation biaisée. La France doit réécouter la diversité des voix iraniennes, y compris celles — silencieuses ou étouffées — qui refusent à la fois la répression intérieure et les ingérences étrangères à but de domination et hostiles à toute forme de développement autonome dans les pays du Sud global.
Elle doit reconnaître la réalité complexe d’un pays souverain, doté d’un peuple très instruit, d’une société dynamique, d’institutions enracinées, d’alliances régionales, et qui joue un rôle central dans l’équilibre géopolitique dans l’Asie de l’Ouest autrement dit le Moyen-Orient.
Déconstruire le mythe : l’Iran ne veut pas “rayer Israël de la carte”
Fonder toute notre analyse de l’Iran sur une citation déformée — « l’Iran veut rayer Israël de la carte » — relève d’un mythe toxique, largement instrumentalisé dans les discours occidentaux. Cette formule, issue d’une traduction douteuse d’un discours prononcé en 2005 par l’ancien président Mahmoud Ahmadinejad, a été sortie de son contexte et utilisée pour
légitimer une hostilité systématique envers la République islamique. Elle ne saurait, à elle seule, servir de boussole politique pour orienter le positionnement de La France vis-à-vis de l’Iran.
Plusieurs experts traduisant le texte original persan (paru sur le site de la présidence iranienne) affirment que les mots “map” et “wipe off” n’y figurent jamais. La citation exacte, plus fidèle à l’original serait alors :
« Ce régime qui occupe Jérusalem doit disparaître de la page du temps. » Suite à cette erreur de traduction, la formule est rapportée en Occident comme Israël doit être rayé de la carte.
La position officielle de l’État iranien n’est pas de « rayer Israël de la carte », mais de soutenir activement toutes les formes de résistance face à l’occupation des territoires palestiniens et au projet colonial du sionisme politique dans la région.
Même si certains slogans ou propos tenus par des dirigeants iraniens peuvent parfois prêter à confusion, il s’agit souvent d’expressions maladroites ou de formules rhétoriques, et non d’une déclaration de guerre. La position officielle de l’État iranien n’est pas de « rayer Israël de la carte », mais de soutenir activement toutes les formes de résistance face à l’occupation des territoires palestiniens et au projet colonial du sionisme politique dans la région.
Lorsque l’on évoque « disparition d’Israël », il faut comprendre cette formulation comme une projection historique : celle de la fin d’un régime d’apartheid, à l’image de la disparition du régime sud-africain dans les années 1990. Il ne s’agit en aucun cas d’un appel à l’extermination ou d’un propos antisémite. Cette position relève d’un engagement géopolitique en faveur de la justice pour les Palestiniens, non d’une haine raciale ou religieuse. Détourner ce discours pour le présenter comme une preuve d’agressivité iranienne constitue une manipulation politique, incompatible avec une lecture honnête des faits.
Pour une révolution sémantique indispensable
Pour construire une politique alternative, lucide et fondée sur le respect mutuel, il est temps de faire un véritable effort sur notre langage politique. Trop souvent, la manière dont on parle de l’Iran trahit déjà un jugement idéologique implicite, voire un mépris culturel persistant.
Les expressions telles que « régime des mollahs », « régime des ayatollahs », « la tyrannie de Téhéran » ou même le flou volontaire de « régime iranien » participent à une stratégie de déshumanisation et de délégitimation. Elles empêchent toute pensée nuancée et rendent impossible un dialogue diplomatique digne.
En France, le mot « mollah » est devenu un terme systématiquement utilisé pour désigner les autorités politiques iraniennes, notamment dans l’expression médiatique omniprésente « le régime des mollahs » ou encore « mollarchie iranienne » est une formule orientaliste qui réduit une civilisation complexe à une caricature obscurantiste. Ce mot, dans son usage français, porte une charge méprisante : il évoque l’obscurantisme, l’autoritarisme religieux, le refus de la modernité et de la rationalité. Il fonctionne comme une formule de disqualification immédiate, sans nuance ni analyse.
Cette vision orientaliste — selon laquelle l’islam serait fondamentalement incompatible avec la science, et aujourd’hui avec la démocratie — persiste toujours, y compris dans les discours de l’extrême droite. Le registre change, mais le mépris reste le même : il vise les musulmans, les sociétés non occidentales, et plus largement les peuples dominés à travers l’histoire.
Nous restons prisonniers d’une dichotomie obsolète entre modernité et tradition. L’illusion persiste que la modernité ne peut surgir que par le rejet du religieux, et qu’elle aboutit naturellement à une démocratie libérale de type occidental. Selon cette vision linéaire et ethnocentrée du progrès, les pays dits “en développement” doivent impérativement suivre ce même parcours : séparer la religion de la sphère publique pour pouvoir accéder à la science, puis à la démocratie.
Mais cette lecture ignore profondément les trajectoires historiques et culturelles propres à chaque civilisation. C’est justement cette incompréhension structurelle qui a empêché beaucoup d’analystes de saisir la nature de la révolution islamique iranienne dès sa naissance. Elle était un phénomène inédit, authentique, porteur d’une autre modernité — ni capitaliste ni marxiste — qui échappait aux grilles d’analyse classiques. Comme l’écrivait Christian Bromberger dès 1980 :
“La Révolution iranienne dérange : elle dérange – faut-il le souligner? – l’équilibre des blocs, les rapports de domination économique et politique sur l’une des régions les plus convoitées du monde ; elle remet en cause la “légitimité” (ou l’illégitimité ?) des relations internationales (cf. l’affaire des otages)… mais elle dérange aussi, effet dérisoire, sans doute, par rapport aux précédents, le confort intellectuel de bien des analystes, déconcertés par l’originalité d’un mouvement qui défie les schémas d’interprétation conventionnels, les habitudes mentales et conceptuelles les plus enracinées. La révolution iranienne n’est le fruit ni d’une manœuvre impérialiste ni d’un soulèvement prolétarien dirigé par un parti d’avant-garde.”
« Pour une révolution sémantique » « Les mots ne sont pas neutres. Dire ‘Asie de l’Ouest’ au lieu de ‘Moyen-Orient’, c’est refuser une géographie coloniale. Parler de ‘République islamique’ plutôt que de ‘régime des mollahs’, c’est reconnaître une complexité institutionnelle. Ce travail sur le langage est le premier pas vers une diplomatie respectueuse. »
Elle dérangeait parce qu’elle imposait un autre langage, une autre grammaire politique, mêlant religieux et politique, croyance et action collective.
L’usage réducteur du terme en France n’est pas nouveau. Il s’enracine dans une tradition orientaliste ancienne, perceptible notamment chez Gustave Flaubert dans Voyage en Orient (1851), où le mollah est représenté comme une figure poussiéreuse, fanatique et figée dans une religiosité archaïque. Si ce regard permettait à l’auteur de construire un contraste entre Orient et Occident dans une visée esthétique ou critique, il contribuait aussi à forger une image de l’Orient comme monde immobile, despotique, irrationnel — en somme, fondamentalement autre.
L’Orient, et en particulier la Perse, fascinaient les philosophes français pour leur raffinement, leur poésie, leur architecture, mais les figures religieuses comme les mollahs y étaient souvent dépeintes comme obstacles à la liberté, au progrès ou à la raison. Ce regard ambivalent a nourri, jusqu’à aujourd’hui, une forme de réduction du mollah à une caricature cléricale, ignorante de sa place dans l’histoire intellectuelle du monde musulman.
Le mot est utilisé comme une catégorie typiquement « orientale », souvent sans nuance. Il devient un symbole d’un clergé supposément rétrograde, autoritaire et conservateur — dans la droite ligne de la vision orientaliste qui s’impose en Europe au XIXe siècle (comme décrite plus tard par Edward Saïd). Pourtant, dans sa langue d’origine, ce mot ne désigne pas un tyran religieux, mais un savant, un érudit formé aux sciences religieuses, juridiques et philosophiques. En persan, « mollā » (ملا) signifie avant tout un homme de savoir.
Ce glissement sémantique entre le sens originel et l’usage péjoratif en français est profondément problématique: C’est une simplification et une exotisation du rôle social du mollah, réduit à une fonction religieuse, sans considération de sa place dans les sciences ou la pensée. Dans l’histoire islamique, loin d’être un frein, la religion a souvent été un moteur du savoir. C’est pourquoi nombre de grands savants étaient aussi des figures religieuses. La connaissance n’était pas en opposition avec la foi, mais en continuité avec elle.
Dans l’histoire de la pensée iranienne, nombre de grandes figures scientifiques, littéraires et philosophiques étaient aussi des religieux. Citons notamment :
Khwârizmî (780-850), mathématicien, géographe, astrologue et astronome persan. Son nom latinisé est à l’origine du mot algorithme;
Avicenne (Ibn Sina) (980–1037), philosophe et médecin dont les traités furent enseignés en Europe pendant des siècles;
Omar Khayyâm (1048–1131), astronome, mathématicien, poète et réformateur du calendrier;
Molla Sadra (1571–1640), fondateur de la philosophie chiite.
Allameh Tabataba’i (1904-1981), poète et philosophe iranien;
Allameh Jafari (1923-1998), intellectuel et philosophe iranien;
Toutes ces figures, respectées dans le monde entier, auraient pu être qualifiées de “mollahs” au sens noble et original du terme.
Réduire cette tradition à un cliché journalistique revient à nier la richesse de la pensée iranienne, à effacer les couches multiples de sa modernité intellectuelle, et à empêcher toute lecture sérieuse de sa réalité sociale et politique.
Il est temps de sortir de cet usage réducteur et méprisant. On ne parle pas du “régime des rabbins” dans le cas d’Isräel, pourtant un “Etat juif” avec une identité religieuse dominante. Pourquoi cette exception iranienne ?
Il suffit d’écouter quelques chroniques sur l’Iran pour les repérer : même lorsque le 13 juin 2025, Israël a mené une attaque directe sur le sol iranien, en
violation flagrante du droit international, les grands médias français ont largement repris des formules préformatées :
– « une guerre préventive d’Israël contre le régime des mollahs » ;
– « le régime des mollahs extrêmement isolé sur la scène internationale » ;
– ou encore : « les mollahs retranchés dans leurs bunkers pendant que la population est sans défense ».
Ce type de discours n’a rien de neutre : il vise à déshumaniser et délégitimer l’Iran, à nier son droit élémentaire à se défendre, et à détourner l’attention de l’opinion publique française du fait brut : celui d’une agression militaire israélienne inacceptable menée avec la complicité des États-Unis, visant notamment des quartiers civils et des hôpitaux, des installations nucléaires, et même la prison d’Evin à Téhéran — le tout dans un silence diplomatique assourdissant.
Si La France aspire à incarner une politique étrangère indépendante, ancrée dans la solidarité entre les peuples, elle doit également mener une révolution sémantique : parler avec rigueur, respect et précision. Cela commence par nommer l’Iran pour ce qu’il est. Pourquoi ne pas parler, par exemple, de son système politique comme de “la République iranienne” ? Cette désignation ouvre à la fois une perspective en résonance avec nos propres valeurs républicaines, et témoigne d’un respect élémentaire envers un système politique qu’il convient d’analyser, non de caricaturer.
Ce travail sémantique doit aussi concerner la manière dont nous nommons la région elle-même. Le terme de « Moyen-Orient » est hérité des cartographies coloniales : il découpe le monde en fonction d’un centre supposé – l’Europe – et positionne les autres peuples en fonction de leur distance à celui-ci (Proche-Orient, Moyen-Orient, Extrême-Orient).
Dire “Asie de l’Ouest” à la place de “Moyen-Orient”, c’est sortir d’une géographie européocentrée, et situer l’Iran, la Palestine, l’Irak ou le Liban dans leur continuité géographique réelle, entre l’Asie centrale, le Caucase et l’Asie du Sud.
Ce changement n’est pas purement symbolique. Il est politique. Il oblige à penser autrement les rapports de force, les alliances, les récits. Et il ouvre la voie à une diplomatie affranchie de la langue de l’Empire.
Changer les mots, c’est déjà changer le regard. Et sans changement de regard, aucune alternative politique sérieuse ne peut émerger. Comprendre l’Iran, c’est reconnaître cette mosaïque culturelle et historique qui défie les simplifications — un peuple multiple mais soudé, dont la résistance ne se réduit pas à un “régime”, mais incarne une civilisation.
Pour construire une véritable politique alternative vis-à-vis de l’Iran, il est urgent de briser le consensus du “politiquement correct” qui prévaut dans la sphère politico-médiatique. Cela implique de remettre en cause les récits dominants, d’oser nommer les faits, et surtout de reconstruire une pensée stratégique indépendante, affranchie des logiques de propagande et de diabolisation.